[Note de l’administrateur de ce blog : on a déjà évoqué ici la fondation Bill (& Melinda) Gates ici, dans une tentative de couler l’alternative principale au vaccin-que-tout-le-monde-attend (puisqu’on vous dit que c’est pour votre bien !), l’hydroxychloroquine. Ici Slobodan Despot traite de façon plus générale, et avec style, de la notion de philanthropie à la mode Gates, et par extension de la notion de courage à la mode journalistique. Article paru aujourd’hui même dans l’Antipresse : si vous l’appréciez, abonnez-vous !]

Photo de Jametlene Reskp sur Unsplash
Dans la série «Fringe», nous découvrons un univers parallèle, tout proche du nôtre, mais avec des lois différentes. L’action réelle des «philanthropes» globalistes tient elle aussi d’un autre monde. L’illusion est si massive qu’elle s’impose comme la réalité de référence. Celui qui la conteste au nom de la raison est logiquement traité de fou.
(Petit rappel du précédent épisode. En investissant des centaines de millions de dollars dans des dizaines d’entités médiatiques, la fondation Bill & Melinda Gates s’est entourée d’une «garde prétorienne» médiatique occupée soit à chanter ses louanges, soit à éconduire les curieux. En conclusion de son importante étude sur les relais médiatiques de Bill Gates, Tim Schwab souligne que «dans la mesure où les journalistes sont censés surveiller les riches et les puissants, M. Gates devrait probablement être l’une des personnes les plus surveillées sur terre, et non la plus admirée.»)
Un vrai premier communiant
L’ingénuité avec laquelle les institutions internationales ainsi que les autorités de divers pays coopèrent avec les programmes sanitaires de Bill Gates est justifiée le plus souvent par l’argument de la philanthropie. Il est normal, après tout, qu’un des hommes les plus riches de la planète veuille consacrer une part de son immense fortune au bien de tous. La feuille de vigne, en l’occurrence, est bien mince. Il n’y a que les journalistes de garde pour ne rien vouloir voir derrière ce cache-sexe. Pour peu qu’on soit un peu curieux, le spectacle est pourtant fascinant.
De manière générale, la « philanthropie » à la mode américaine est à manier avec une longue cuiller. C’est pourtant le premier « titre » qu’on accole dans les médias de perdition aux capitaines du capitalisme financier.
Or à quoi rime une « bienfaisance » qui non seulement ne coûte rien au «bienfaiteur» mais contribue au contraire à l’enrichir encore davantage ? Comme le note, de manière un peu lapidaire, la journaliste indépendante Caitlin Johnstone, « ce mot n’est qu’une étiquette qu’on attache aux ploutocrates parasites qui donnent un très petit pourcentage de leur richesse à des organismes de bienfaisance exonérés d’impôt afin que le petit peuple ne s’aperçoive pas qu’il vit sous une ploutocratie et ne se mette à fourbir les guillotines ».







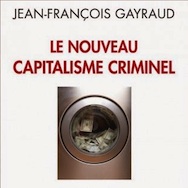








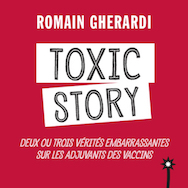

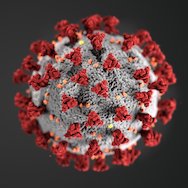




































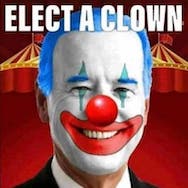




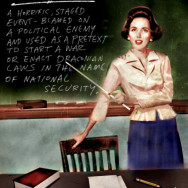



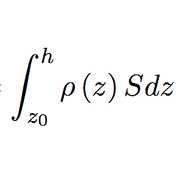




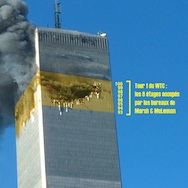



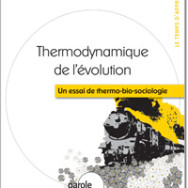




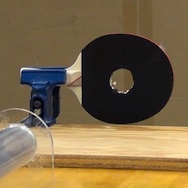



















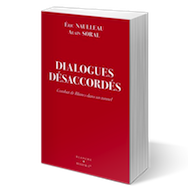




























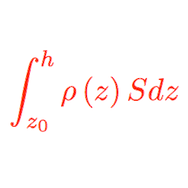













 Vous l’avez compris dès la lecture du titre, les guillemets sont nécessaires : les premiers pour étendre les bases de la philanthropie à tous ceux qui veulent d’abord créer le chaos pour pouvoir reconstruire le monde à leur idée, et les seconds pour bien insister sur la véracité de la citation. Dans un article du 24 mars 2020
Vous l’avez compris dès la lecture du titre, les guillemets sont nécessaires : les premiers pour étendre les bases de la philanthropie à tous ceux qui veulent d’abord créer le chaos pour pouvoir reconstruire le monde à leur idée, et les seconds pour bien insister sur la véracité de la citation. Dans un article du 24 mars 2020