 Le genre : le mondialisme expliqué aux naïfs.
Le genre : le mondialisme expliqué aux naïfs.
Ayant lu ce livre en 2014 peu après sa sortie, j’ai longtemps retardé la rédaction d’une note de lecture le concernant. Non parce qu’il ne me semblait pas être un ouvrage prioritaire, mais au contraire parce que la variété des sujets abordés, que le titre laisse mal présager, et la justesse des analyses développées par Hervé Juvin, répondant parfaitement à de très nombreux questionnements de mes contemporains dans une époque troublée, en font au contraire une œuvre majeure que l’on doit considérer avec grand respect, et à laquelle on a spontanément peur de ne pas rendre justice par un modeste article de blog. Mais l’époque étant ce qu’elle est, et les fous ayant déjà en main les clés de l’asile, j’ai enfin décidé de mettre un terme à cette procrastination.
La couverture pourrait faire penser à un livre d’ethnologie traitant du nécessaire respect des “peuples primitifs”, requalifiés “peuples premiers” par la novlangue politiquement correcte. Il n’en est rien : si l’auteur illustre bien ses propos par quelques exemples tirés de sa connaissance de civilisations “exotiques”, c’est un peu à la manière des Lettres Persanes de Montesquieu (tiens, une des mascottes de ce blog…), afin de nous faire mieux percevoir le désastre évolutif de notre monde “civilisé”, disons “occidental” pour faire simple, et l’abîme nihiliste vers lequel il se précipite.
Avec De l’esprit des loix (orthographe de l’époque), Montesquieu nous livrait en 1748 une analyse révolutionnaire des modes de gouvernement, qu’il faisait dépendre de contraintes naturelles – telles que le climat – ou culturelles, pour s’abstenir de juger les régimes politiques sur des critères absolus mais les présenter comme autant de compromis ajustables, dépendant de la Nature et des Hommes. Ce relativisme lui vaudra logiquement d’être mis à l’Index par l’Église, qui constituait un des piliers du pouvoir monarchique de droit divin de l’époque.
Avec La grande séparation, Hervé Juvin nous fait prendre conscience d’un autre absolutisme qui, sournoisement, a remplacé celui de l’Ancien Régime. Un système totalitaire qui s’est paré de toutes les vertus du Progrès pour mieux s’imposer à notre insu, une prison idéologique d’autant plus invisible qu’elle s’étend dans pratiquement tous les domaines, privés et publics, de notre monde “moderne” et “développé”. Un totalitarisme global qui, sans doute, aurait sauté aux yeux d’un Montesquieu soudainement transporté en ce début de vingt-et-unième siècle, tant il s’oppose aux réflexions sociologiques de son œuvre maîtresse.
Les Lumières ont indéniablement mis un terme à une forme de pouvoir, qu’il soit politique ou simplement intellectuel, basée sur l’obéissance à une hiérarchie immuable ; mais en plaçant l’individu et les lois naturelles au-dessus de tout, voire l’individu au-dessus des lois naturelles, ce mouvement philosophique a fini par donner naissance, nous dit Hervé Juvin, à une illusion dangereuse : celle de l’homme hors-sol, déconnecté de ses racines comme de son histoire, et nécessairement universel. Un homme tellement libéré de ses anciennes chaînes qu’il flotte désormais dans un no man’s land indéfini. Un individu à la potentialité d’action tellement grande qu’il est devenu la proie rêvée pour toutes les manipulations1, conçues par plus malin que lui, tout en se croyant de plus en plus autonome et maître de ses décisions. Et en premier lieu, le sujet parfait pour le Marché, ce nouveau dieu bien plus exigeant en sacrifices que les anciens. Ainsi, p. 119 :
“Nous sommes ceux qui ne peuvent plus se définir. Nous sommes ceux qui ne peuvent plus dire qui ils sont, puisque toute définition exclut et discrimine, puisque toute définition est une détermination. Nous étions des hommes définis par des origines, une citoyenneté, des appartenances. Nous devenons des individus interchangeables, négociables par blocs, comme ces “pains de viande” où se mêlent indistinctement muscles, tendons, poussière d’os et viande, comme ces produits financiers qui mêlent obligations, options monétaires, et qui ne sont définis que par une marque et une quantité – et des risques cachés.”
Hervé Juvin moque avec justesse, dans les mêmes pages, les prétentions des grands donneurs de leçons néo-coloniales que sont nos dirigeants “occidentaux” ou même certaines autorités religieuses, dont on peut se demander si leur rôle n’est pas de détruire les bases de la civilisation plutôt que de les préserver. Ainsi sur Barack Obama :
“Parmi tous, le célèbre discours du Caire, prononcé par le président Barack Obama, est l’expression la plus achevée, en même temps que la plus agressive sur le fond à l’encontre de l’islam, des religions et, plus encore, à tous ceux qui se vivent, qui demeurent et qui veulent demeurer déterminés par leur foi, leur communauté, et dire nous ; il est vrai qu’un président des États-Unis a certainement la compétence nécessaire pour enseigner aux musulmans ce qu’est leur vraie religion, une version accommodée aux marges de l’intérêt national américain !”
Et sur l’ancien archevêque de Paris :
“Le cardinal Lustiger s’était livré à la même braderie, faisant du catholicisme un viatique de la société apaisée, un adoucissement du capitalisme sans risque et bon marché. Il ne s’agit plus de chasser les marchands du Temple, il s’agit d’aider leurs affaires !”
Ce rejet des carcans culturels et religieux aboutit in fine, nous explique Hervé Juvin au chapitre 3, Démocratie sans terre, à la fin de la politique et à la mise en esclavage de l’humanité au nom du droit. Un diagnostic qui rappelle beaucoup celui porté par Valérie Bugault dans la longue série d’articles que j’avais repris ici même. Ainsi lit-on p. 147 :
“Derrière la mise hors-sol de l’homme de rien, derrière la mise en équivalence généralisée des emplois, des capitaux, des modèles et des systèmes, le droit. Le droit a été le vecteur primordial de l’idéologie du même et de la destruction de la diversité. Le droit des contrats nourrit l’illusion d’une dispense du politique et d’un arrêt de l’histoire ; rien ne peut se substituer au contrat, rien ne peut changer les règles qui assurent à chacun la poursuite du bonheur. Il transforme la démocratie de l’intérieur, en la subordonnant à des règles, des procédures, des systèmes, étrangers à la volonté des citoyens, voire à leur conscience. Il fait de la fraude, du mensonge ou du crime, les substituts au combat politique devenu impossible. George Soros, Bernard Madoff, la banque Goldman Sachs ou HSBC suscitent dans la fraude, le mensonge et le vol, le respect naguère dû aux rebelles, aux révoltés, aux résistants. Ils savent y faire ! Ils jouent avec le droit, les règles et les normes, comme d’autres jouaient avec le pouvoir et l’autorité.”
Un droit qui vient en appui de la puissance économique, comme facilitateur du commerce, mais toujours au profit du plus fort2 ; un droit qui n’appuie donc en définitive que la négation même de l’idée de justice. Il est intéressant de remarquer que Juvin cite, p. 169, un extrait de l’Esprit des lois de Montesquieu pour contredire son auteur, qui souhaitait “le plus de commerce possible, le moins de politique possible”. Il argumente ainsi :
“La richesse de la Grande-Bretagne, celle des États-Unis, celle d’autres pays européens ont été bâties sur un emploi illimité de la force pour satisfaire des intérêts marchands et financiers, sur un emploi sans états d’âme de la finance et du marché pour réaliser des objectifs politiques, en premier lieu l’homogénéisation des sociétés occidentales, l’ensemble assorti d’une prétention permanente à détenir le bien. Ce n’est pas qu’une violence occasionnelle a servi la civilisation de l’économie, c’est que la civilisation de l’économie est une violence supérieure, supérieure parce que le droit la rend implacable et la certitude du bien, insensible.” 3
Mais cette opposition à Montesquieu n’est en fait qu’apparente dans la mesure où celui-ci, parlant au milieu du dix-huitième siècle, ne connaissait pas la tyrannie du commerce global et du droit supranational qui fait notre monde ; il était naturel à cette époque qu’il exprimât un souhait de davantage de commerce, car c’était bien pour lui le politique – la monarchie absolue de droit divin – qui incarnait la tyrannie. Deux siècles et demi plus tard, le balancier s’est déplacé de l’autre côté.
Le règne du marché, qui impose l’uniformisation du droit, implique la négation de ce qui fait la diversité humaine, nous explique Hervé Juvin au chapitre 4, La fin des autres. Et l’outil de cette standardisation, de ce rabotage implacable après lequel rien ne doit dépasser, est le formatage idéologique auquel se livrent des groupes de pression prétendument “antiracistes”, mais en réalité d’une hypocrisie virant souvent au ridicule le plus achevé. Hervé Juvin nous livre ainsi (p. 230) une expérience vécue en Inde avec un guide :
“Sarat, le guide, dit d’emblée à Raipur ce qui ne peut plus se dire, dans une petite leçon d’ethnologie comparée : pour reconnaître les tribus, il faut apprendre à regarder les oreilles, les yeux, les cheveux, les lèvres, et l’ensemble de la stature corporelle. Et il joint le geste à la parole pour illustrer les caractères ethniques de chacune des cinq ou six tribus les plus fréquemment rencontrées, avec une attention pleine de compassion pour ces Occidentaux qui ont désappris à voir, à comparer et à distinguer, ces hommes qui ne savent plus voir ce qui fait les hommes de quelque part et des leurs. Comment lui expliquer cette cécité voulue, cet aveuglement enseigné, qui est une autre forme de séparation d’avec soi et les siens ? Soixante-deux tribus, rien qu’en Orissa ! Soixante-deux tribus, quand un Français ne saurait plus reconnaître un blond d’un brun et quand le seul emploi du mot “race” le rend suspect !“
Mais le nivellement des différences nécessaire à l’avènement de l’homme de rien ne saurait être pleinement réalisé sans le nivellement des sexes, voire leur indétermination, l’égalité de “droits” pour toutes les préférences sexuelles – débouchant naturellement sur l’immense marché de la GPA – ou même le libre choix de son sexe4, ce qui va bien plus loin que la remise en cause de structures humaines puisque la reproduction sexuée serait, selon nos connaissances actuelles, vieille de plus d’un milliard d’années sur Terre. On n’arrête pas le Progrès… mais il pourrait bien s’arrêter de lui-même, en une étrange répétition des récits bibliques que Hervé Juvin rappelle p. 357 :
“Nous appliquons à la Bible nos obsessions, et avons perdu la clé de l’histoire qu’elle raconte et de l’enseignement qu’elle délivre. Sodome et Gomorrhe sont devenues les emblèmes de la liberté sexuelle poussée à l’extrême, et de l’antique répression de pratiques ou de mœurs que nous chérissons comme manifestations de la liberté individuelle et de l’indétermination, dont l’apogée réside dans le libre choix de leur sexe par des hommes ou des femmes dont la nature ne saurait déterminer le genre à la naissance ; leur désir seul doit y pourvoir. La destruction par le feu divin de Sodome et Gomorrhe est dans la Bible provoquée par tout autre chose que des excès ou des déviations sexuelles : les enfants y naissent sans pères, il n’y a pas d’état civil et la confusion des lignées et des noms est la règle. C’est ce qui est détruit, la possibilité que des enfants naissent et grandissent sans pouvoir reconnaître ceux qui leur ont donné la vie et puissent, comme leur assigne le Deutéronome, “leur donner juste mesure” , ce qui leur revient, à eux qui ont donné la vie, pour que leurs enfants vivent longuement sur la terre qui leur a été donnée.”
Et la libération de toute contrainte débouche tout aussi logiquement, nous dit l’auteur, sur le transhumanisme et sa volonté démiurgique d’augmenter l’homme, d’effacer sur lui les marques du temps afin qu’il soit toujours conforme à l’idéal de santé et de jeunesse que lui renvoie la publicité nécessaire au Marché, voire de le libérer de la mort. Mais serait-ce vraiment une libération ?
Terminons cette note de lecture par une critique : un des passages du livre, Menaces sur Israël ? (pp. 234 à 238) est tout à la fois très intéressant et logiquement insuffisant, comme si l’auteur n’avait pas voulu aller au bout de son raisonnement. Prenant l’exemple israélien comme contrepied de l’idéologie mondialiste et sans-frontiériste, Hervé Juvin note avec raison que celle-ci, prise à la lettre, doit être considérée comme la première menace pesant sur Israël. Et il n’hésite pas à écrire, p. 234 :
“La dénonciation d’Israël, dans son projet et dans sa singularité, est au cœur de la création de l’homme nouveau. Sa logique est celle du mondialisme, celle de la réduction de l’homme au droit, et de son identité à son utilité. Le mondialisme et le sans-frontiérisme sont incompatibles avec l’existence d’un État juif.”
En affirmant ceci, l’auteur semble ne pas avoir remarqué – fait-il semblant ? – que les plus ardents défenseurs de l’idéologie mondialiste et sans-frontiériste, d’Attali à BHL, de feu Glucksmann à Kouchner, de Jakubowicz au très peu regretté Valls, sont ou étaient également d’inconditionnels défenseurs du régime sioniste, même dans ses pires excès. Il semble également ne pas voir – au contraire d’un Christophe Oberlin dont j’ai déjà parlé ici – que cet “État” d’Israël, si l’on y regarde à deux fois, n’est tout simplement pas un État (où sont ses frontières ?) mais plutôt un groupe de pression disposant d’une base territoriale, un lobby sédentarisé qui ne vit que par et pour l’influence de sa diaspora, en bénéficiant notamment de grandes largesses financières de la part des États-Unis d’Amérique. Il semble ne pas comprendre que la dénonciation d’Israël ne concerne pas l’affirmation d’une identité – celle des juifs – mais au contraire la négation d’une identité, celle des habitants de la Palestine chassés pour accomplir le projet sioniste, comprenant beaucoup d’Arabes musulmans dont les villages et même les cimetières furent rasés5, mais aussi des chrétiens ou des juifs enracinés depuis des générations et qui ne souhaitaient pas l’arrivée en masse de colons. Il semble ne pas avoir remarqué que parmi les sionistes mondialistes cités plus haut, les plus transparents comme Jacques Attali revendiquent ouvertement de faire de Jérusalem la capitale d’un gouvernement mondial.
Autrement dit, il est assez évident pour qui creuse même superficiellement la question, que personne ne dénonce Israël pour sa volonté d’être une nation, mais bien pour sa volonté d’être une supra-nation surplombant les autres, née sur la négation des droits d’un peuple6 – en parfaite contradiction avec le projet sioniste initial de Theodor Herzl, rappelons-le au passage – et, en conséquence, une nation se moquant ouvertement du droit international qui – théoriquement – protège encore un peu les peuples dans leur identité et leur volonté d’autodétermination. Si “le mondialisme et le sans-frontiérisme sont incompatibles avec l’existence d’un État juif” , c’est en réalité parce que cet État – ou pseudo-État – ne s’est jamais considéré comme une nation parmi les autres mais a toujours œuvré à l’affaiblissement des autres nations – ses voisins d’abord, mais aussi bien au-delà – notamment par l’action d’une diaspora très influente. Ce n’est pas d’être une nation qui est reproché à Israël, mais au contraire de ne pas vouloir en être une comme les autres, ce qui implique certes des droits mais aussi des devoirs.
Ce point aveugle (volontaire ?) du livre d’Hervé Juvin est d’autant plus étonnant qu’il expose parfaitement, p. 335, les desseins d’une oligarchie mondialisée, liée de façon évidente à la haute finance et au complexe militaro-industriel, tous deux d’une grande importance pour l’économie israélienne et qui veillent respectivement à entretenir la dette et les conflits pour mieux soumettre les peuples :
“Derrière l’artificialisation croissante de la société des individus, son abstraction, son constructivisme, il faut reconnaître une opération stratégique de grande ampleur, une opération dont les États-Unis sont l’instrument plus qu’ils n’en sont l’acteur, une opération qui tend à mettre en place un gouvernement mondial apolitique, adémocratique et anational, le gouvernement de la nouvelle classe dominante mondiale.”
Étonnant donc, de voir en l’État d’Israël un obstacle ou un contre-exemple au mondialisme (ce qu’il est en effet, factuellement), alors qu’il en est au contraire un des instruments, justement par sa propension à s’affranchir unilatéralement des règles gouvernant les rapports entre les nations et à se voir comme un rouage essentiel d’une dominance planétaire. Mais cette note dissonante ne peut en aucun cas gâcher le plaisir de lire Hervé Juvin, qui pointe avec une clarté implacable les voies sans issues qui obscurcissent sur tous les fronts le devenir de notre civilisation.
Bien que déjà longue, cette note de lecture ne rend pourtant pas justice au foisonnement des thèmes développés par Hervé Juvin. Que mes lecteurs me pardonnent, je terminerai de façon peu élégante par une liste non exhaustive de sujets dont je n’ai pas parlé : l’immigration massive (p. 101), le terrorisme “islamique” (p. 113), l’artificialisation du monde par la multiplication des signaux, règles et interdictions (p. 133), les risques du virtuel (p. 141), l’Union Européenne comme entreprise de soumission des vainqueurs de la deuxième guerre mondiale (p. 129, p. 162), l’atroce guerre d’extermination des USA contre les Philippines (1898-1909) que tout le monde a oubliée (p. 171), les guerres contemporaines faites par l’armée française mais contre les intérêts de la France (p. 177), l’assistanat comme nouvelle forme d’esclavage (p. 181), les organismes génétiquement modifiés (p. 226), le retournement de la notion d’État, jadis protecteur et aujourd’hui oppresseur de ses citoyens (p. 268), le principe d’ingérence et le rôle très trouble des ONG (p. 351)…
Je ne peux donc qu’enjoindre mes lecteurs à courir se procurer cet ouvrage essentiel, qui les éclairera à chaque page sur l’origine des malheurs de notre monde, et leur permettra donc de contribuer à leur tour à le faire dévier du précipice vers lequel il se dirige avec empressement au nom du bien et du Progrès.
P. S. : et pardon à mes lecteurs pour l’absence de poisson, qu’ils attendaient peut-être…
- Hervé Juvin résume très bien ce retournement par une phrase (p. 138) : “Nous avons vécu une société de la liberté, et nos libertés sont labourées par des exploitants industriels qui mesurent le profit à en tirer.”
- “Le droit réalise les conditions de ce qui succède à l’empire ; la capacité d’agir universelle, le pouvoir mondial des investisseurs privés.” (p. 153)
- p. 289 Hervé Juvin a aussi cette excellente formule : “Nous n’avons plus d’ennemis, nous affrontons ceux qui refusent le bien qu’on leur fait !”
- Goldman Sachs, cette association humaniste bien connue, avait annoncé peu avant la faillite de Lehman Brothers que désormais, soucieuse du bien-être de ses employés, elle leur remboursait les opération de changement de sexe (p. 139).
- Comble d’ironie, Yad Vashem, qui se veut le lieu de mémoire par excellence, est situé sur une colline à moins d’un kilomètre en face de l’ancien village palestinien de Deir Yassin, qui fut rasé en 1948 après le massacre de ses habitants, ce qui valut à Albert Einstein la fameuse lettre d’indignation dont j’ai plusieurs fois parlé ici. Et aujourd’hui même les guides de Yad Vashem ne sont pas libres de rappeler la véritable histoire de l’État d’Israël, tandis que les “administrateurs” de Wikipédia, avec la mauvaise foi qui les caractérise, rejettent avec mépris tout rappel historique dérangeant.
- Comme les USA…









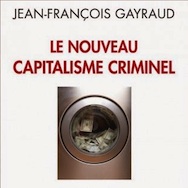















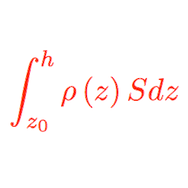


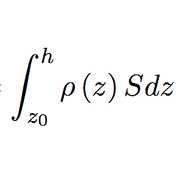





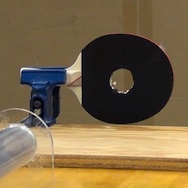




























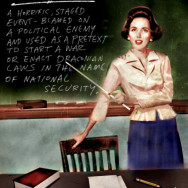






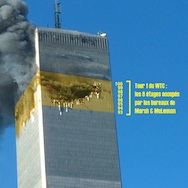




































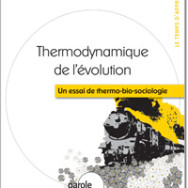




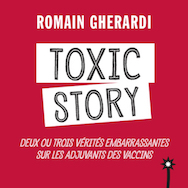







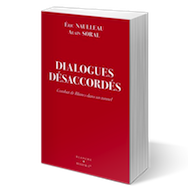



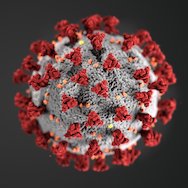








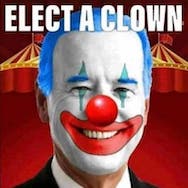












“… car c’était bien pour lui le politique – la monarchie absolue de droit divin – qui incarnait la tyrannie.”
Si Hervé Juvin se trompe sur les objectifs de l’entité sioniste, M. Roby vous vous trompez sur la nature de l’Ancien Régime. Je vous invite à visionner quelques vidéos de Marion Sigaut et de Pierre Hillard pour vous détromper.
C’est possible, je n’ai pas spécialement étudié la question ! Mais à vrai dire j’essayais seulement de me mettre à la place de Montesquieu, et il n’est pas contestable que pour lui, le commerce était de loin préférable à la politique puisqu’il l’a écrit. Or il vivait sous l’Ancien Régime… quelle forme de pouvoir politique pouvait lui donner aussi mauvaise impression d’après vous ?
Si Montesquieu avait vécu deux siècles il aurait vécu jusqu’à la Troisième République et il aurait alors pu comparer la Troisième République à l’Ancien Régime et cela m’étonnerait fort qu’il aurait préféré la Troisième république.
C’est fort possible… d’ailleurs on sait à quel point la Troisième République a pu justifier la colonisation en étant certaine d’apporter la civilisation aux sauvages, alors que Montesquieu n’appréciait pas particulièrement l’idée d’une hiérarchie des races.