
La ziggourat de Babylone, ayant donné naissance
au mythe de la Tour de Babel
(suggestion de présentation).
[Note de l’administrateur de ce blog : en complément de ce long article de Cadet Roussel, on pourra lire les non moins longs et non moins excellents articles de Valérie Bugault, publiés sur le saker francophone et que j’avais relayés ici même, sur l’aspect juridique et économique de la dictature oligarchique anglo-saxonne.]
Sur le plateau de Saclay, à trente kilomètres au Sud de Paris, une énorme ziggourat est en projet. Elle devrait s’élever jusqu’au ciel. Plusieurs bâtiments sont déjà construits, d’autres sortent de terre, d’autres encore sortent un moment des cartons pour y replonger bientôt. Les maçons ceignent leur tablier, prennent leur compas et saisissent leur truelle : leur chef d’œuvre sera la Grande Université Française, une géante, destinée dans l’imaginaire de ses promoteurs “à rivaliser à l’international”. Porte-parole des visionnaires, le journal Le Monde s’emballe : « L’enjeu est simple : pour peser dans la compétition mondiale, chaque pays rassemble ses forces. À Singapour, Doha ou Lausanne, des universités mettent le turbo pour tailler des croupières aux éminences établies : Harvard, Cambridge ou Zurich… C’est le choc des titans, froidement départagé par les classements internationaux. Le titan français, ce sera l’université Paris-Saclay (UPS). »
Selon les spécialistes de la forte taille – comme on dit dans la confection – l’Université Paris-Saclay deviendra l’une des vingt plus grosses au monde. Cette ambition, solennellement et périodiquement réaffirmée, mérite bien une définition en anglais, que le journaliste du Monde nous donne avec gourmandise : elle sera bien une “integrated research intensive university”. À l’usage des ignorants : une université intégrée intensive en recherche. Bien entendu, l’excellence a été dûment convoquée. L’Excellence est tenue de fréquenter l’université depuis que les ambassadeurs ont été ravalés au rang de taxis d’aéroport pour ministres en voyage.
Penchées sur le berceau, baguette magique à la main, pas moins de dix-huit institutions d’enseignement supérieur : Polytechnique, Centrale, Supélec, l’Agro, l’ENSTA, l’ENS de Cachan, l’université Paris-Sud, HEC… rien que du gratin. Impavides, les partisans de cette université encore dans les limbes affirment qu’elle devrait devenir – oyez, oyez – le “Cambridge français”. Ingénu et lyrique, le journaliste du Monde décrit la vision des fidèles : “Du fait du prestige de ses membres et de son poids dans la recherche nationale (15 %), le cas Paris-Saclay fait figure de symbole. Figé depuis deux cents ans, archaïque et inégalitaire par bien des aspects, le système français d’enseignement supérieur est en train de muter en profondeur, bousculé par la violence de la compétition internationale.”
Bien entendu, l’enseignement supérieur a beaucoup changé en France au cours des deux derniers siècles, quoique le journaliste l’ignore. Et malgré les inégalités de prestige entre les établissements, l’enseignement supérieur français est l’un des plus égalitaires au monde, puisqu’il permet à tous les bacheliers de faire des études à un coût modique. Ce torrent de mots ne serait que ridicule si ce projet n’était dangereux. Sept bonnes raisons, au moins, incitent à refuser cette folie :
-
La très petite taille assure mal l’efficacité, mais la très grande taille ne peut que susciter la pagaille.
Afin d’être “visible à l’international”, chacune des “grandes écoles” s’efforce déjà d’atteindre “la taille critique”, au-delà de laquelle, bien sûr, les réactions en chaîne déclenchent l’explosion. Les directeurs s’entrechoquent. Guerres picrocholines au service d’ambitions lilliputiennes, suspendues par des armistices gagés sur des promotions. L’inflation résultante de directeurs les rendra bientôt presque aussi nombreux que les élèves : directeur des études, directeur de la formation, directeur de la recherche, directeur de la formation par la recherche, directeur des relations internationales (dit, en une grandiloquente abréviation, “directeur de l’international”)… Ces titres ne sortent pas de l’imagination de Vian, Borgès ou Garcia-Marquez : esclaffez-vous si cette énumération vous paraît drôle, mais sachez que rien n’est inventé. Et, bien entendu, tout directeur ne se sent vivre, ne peut commencer à déployer ses talents, que s’il est entouré de collaborateurs, chacun dûment secondé par des secrétaires.
Le surhaussement régulier des pyramides écrase déjà les écoles d’ingénieurs. Or un conglomérat d’établissements moyens ne fait pas un grand établissement puissant, mais un paralytique impuissant. Plus haute la ziggourat, plus grand le mirage du pouvoir, et plus féroces les rivalités. Dans ces étagères à fromages, les décisions sont prises par l’intrigue et le coup fourré. Garantie absolue de mise en œuvre du principe de Peter.
Pour s’imposer dans l’organigramme de l’université en projet, les nombreux directeurs des écoles d’ingénieurs de Paris se réunissent, s’allient et s’opposent, se groupent et se regroupent, par factions mouvantes. Pour atteindre le sommet et s’y maintenir, les parasites rivalisent farouchement. Luttes qui seraient homériques si les champions s’affrontaient au grand jour, aux yeux de tous et pour les yeux de la plus belle Hélène que les humains aient jamais courtisée : la connaissance. Hélas, ils ne veulent que régner dans Ilion.
N’étant encore qu’un sigle, l’UPS est déjà déchirée par une polémique sur les émoluments du déjà président de la future université, qui a quitté le CEA à la suite d’une lutte au sommet. L’attribution des crédits des LABEX (« laboratoires d’excellence », on ne rit pas) est dès à présent tout à fait opaque, et les résultats ne sont même pas publiés officiellement. La paralysie ne fera que progresser avec la taille de l’organisme.
Seule réaliste, l’École Polytechnique ne participe au projet que dans la candide intention de s’annexer les écoles spécialisées dont ses élèves suivent les cours pendant leur année d’application. Pour des polytechniciens, une grande université ne saurait être qu’une extension de leur maison mère, prima inter impares.
“L’excellence se constate, elle ne se décrète pas, et rien n’est plus grotesque que de se faire fort de l’organiser.”
Bologne, Montpellier, La Sorbonne, Cambridge, Oxford, Salamanque, Heidelberg, Tübingen, Karolinska, tous ces noms doivent leur prestige à l’ancienneté, l’enracinement, la tradition, la persévérance nécessaire à la fécondité intellectuelle. L’excellence se constate, elle ne se décrète pas, et rien n’est plus grotesque que de se faire fort de l’organiser. Insulte au bon sens, la comparaison d’une université inexistante à la séculaire université de Cambridge fait rougir ; mais, comme les journalistes et les politiciens, les universitaires sont sans vergogne.
Pourtant les institutions anciennes sont nombreuses en France, et une foule d’institutions novatrices ont été crées dans le dernier demi-siècle. Les autorités politiques doivent leur donner les moyens de se développer et les aider à coopérer, mais sans les révolutionner d’en haut.
Intégrer les écoles d’ingénieurs dans des universités permettrait d’atténuer les hiérarchies traditionnelles entre ces établissements, de redonner le goût de la recherche à ces écoles qui pour la plupart s’en détournent, et d’améliorer ainsi l’aptitude des ingénieurs à la démarche scientifique. Mais atteindre ces buts ne nécessite pas de constituer une université énorme et hétéroclite, à trente kilomètres de la capitale. Le premier effet de sa construction est d’entraîner un important transfert du budget de la recherche vers les caisses des entreprises de BTP, de même que le désamiantage des bâtiments de Jussieu (université Paris 6) permit à des promoteurs de faire payer au ministère de la recherche la location à haut prix, et pendant des années, de bureaux jusqu’alors restés vides.
-
L’université de Changhaï est inconnue en tout domaine, hormis pour ce classement sans queue ni tête.
Le « classement de Changhaï » range à la queue-leu-leu les établissements universitaires du monde entier, selon un critère composite combinant les nombres de prix Nobel, de doctorats, d’articles publiés et d’étudiants payants, le tout divisé par la longueur des moustaches du recteur (pardon pour ce sexisme). Selon les goûts, le résultat peut s’exprimer en tonnes ou en hectares.
“C’est comme si l’on demandait à un géologue de ranger tous les cailloux qu’il connaît par ordre de taille.”
Quels que soient leur spécialité et leurs effectifs, tous les établissements sont classés dans la même liste. Ainsi, en France, l’École Polytechnique, qui est en principe une faculté d’ingénierie, ou les Écoles Normales Supérieures, ensembles de collèges universitaires, sont mises sur le même pied que les grandes universités aux très nombreux départements et aux effectifs pléthoriques, comme les universités des capitales provinciales, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Marseille, ou les universités Paris 6 ou Paris 7. Le mélange d’établissements très différents ôte toute pertinence au « classement de Changhaï », gargarisme pour bureaucrates. C’est comme si l’on demandait à un géologue de ranger tous les cailloux qu’il connaît par ordre de taille.
Cette imposture ne serait que comique si elle ne révélait l’orientation imposée aux universités par les détenteurs du pouvoir économique. Il s’agit d’organiser le “marché des étudiants” en fournissant aux clients un catalogue de prestataires de services évalués par un indice boursier. Le Monde s’en fait encore l’écho : « Les meilleurs étudiants en master et doctorat scrutent les classements pour choisir l’établissement étranger qui leur donnera la meilleure « marque ». » L’avenir que les banquiers dessinent existe déjà dans les pays anglo-saxons – toujours précurseurs -, où des diplômés des universités remboursent chaque mois leur prêt universitaire pendant des années, parfois des décennies après avoir fini leurs études, voire même après la retraite. Ne faut-il pas « responsabiliser les consommateurs » ? Inciter les familles à calculer les coûts et les avantages des études, afin de les sortir de « l’assistanat » auquel les voue l’enseignement public ?
D’autres classements, plus raisonnables quoique fondés sur la même idée absurde d’aligner des perles, répartissent les établissements universitaires par spécialités et effectifs (ou par couleur, pour qui a l’oreille absolue), mais celui de Changhaï, est celui qui plaît le plus, peut-être parce qu’il est le plus loufoque. Parmi les universitaires, les classements remportent de vifs succès. C’est que, faute du courage de se colleter à la création de connaissances nouvelles, on peut borner son ambition universitaire à diriger. À la paresse d’examiner des travaux scientifiques, au désir de puissance, tout classement offre un prétexte paré de l’apparence d’une mesure objective. Aubaine ! Pour occuper le plus de place possible au soleil de l’évaluation, les universités veulent devenir aussi grosses que le boeuf. En vrais chefs d’entreprises, leurs dirigeants mènent donc des fusions-acquisitions, dans l’intérêt de tous, bien entendu. Ainsi, l’université de Bourgogne s’efforce-t-elle d’absorber l’université de Franche-Comté. Un autre exemple attendrissant de cette course à l’embonpoint est celui des universités littéraires parisiennes qui se séparèrent dans le mélodrame en 1968, chacune cherchant à l’époque à se distinguer, et toutes avides de multiplier les « présidents ». À présent, elles reviennent se blottir ensemble sous le nom prestigieux de La Sorbonne. Plaisante illustration de l’éternel retour. Le titre historique de Recteur de la Sorbonne, bientôt restauré, deviendra un hochet convoité. Belles bagarres en perspectives.
-
L’esprit de compétition mène au conformisme ; contraire à la vitalité intellectuelle, il ne peut que lui nuire.
Comme toute l’évolution sociale contemporaine, et dans le même mouvement (dessein ?), l’organisation de la recherche est de plus en plus infantilisante et bureaucratique. Outre les rapports d’avancement de chaque projet, des rapports d’activité sont demandés aux chercheurs deux fois par an. L’Agence Nationale de la Recherche (ANR), ou l’Agence Européenne de la Recherche, sont des usines à gaz dont les tuyaux ne sont même pas connus de leurs propres plombiers. Les projets y sont sélectionnés au doigt mouillé, et faute de moyens (même l’accès aux revues internationales est difficile aux agents de l’ANR), nul ne contrôle si les évaluateurs développent ensuite eux-mêmes les thèmes exposés dans les projets qu’ils ont expertisés. Les décisions sont motivées très vaguement et les recours relèvent de la parodie. En effet le comité d’experts chargé de la réévaluation n’a qu’un avis consultatif, la décision finale étant prise par la direction des investissements. Comme les délais d’examen en recours sont longs, un projet accepté après réévaluation ne pourrait être financé qu’en réduisant les crédits déjà attribués à d’autre projets. Il faudrait déshabiller Pierre pour habiller Paul. La commission de recours n’est donc qu’un service de pompes funèbres organisant des enterrements de première classe pour grincheux.
Le détail des formulaires va jusqu’à faire calculer par les auteurs d’un projet scientifique le montant mensuel des cotisations sociales des collaborateurs temporaires qu’ils espèrent engager, si par bonheur le projet est retenu. Les demandes de crédits occupent donc plusieurs mois d’activité. Or à peine 8% des projets sont financés, et toujours pendant une durée trop courte pour mener une recherche de longue haleine. Aussi le principal effort intellectuel à fournir, pour rédiger un projet, est-il de chercher à déjouer les interprétations de mauvaise foi, que les experts sont bien obligés de fournir pour éliminer la grande masse des projets. Exposer la thématique scientifique est finalement le plus facile. Faut-il penser que 92 % des projets sont sans intérêt ? Les chercheurs pourraient sans remords partir pour longtemps en vacances. Face à la grogne générale, l’ANR a libéralement décidé de financer cette année 13% des projets. Peut mieux faire en s’en donnant la peine.
“L’Agence Nationale de la Recherche est ainsi une officine d’espionnage officielle, aux frais des Français et au profit des Anglo-saxons.”
À chaque appel à projets, les chercheurs doivent exposer toutes leurs hypothèses scientifiques en détail, presque toujours dans une langue étrangère, sous prétexte d’évaluation objective par des experts anonymes dispersés aux quatre coins de la boule ronde. Cependant, en réalité, les projets sont toujours examinés par les mêmes experts “internationaux” (mais soumis à de pressants intérêts nationaux), dont la veille documentaire est ainsi grandement facilitée. L’Agence Nationale de la Recherche est ainsi une officine d’espionnage officielle, aux frais des Français et au profit des Anglo-saxons.
Après avoir franchi tous ces obstacles, en cas improbable de succès, survient le braquage que font subir les institutions à leurs collaborateurs. En effet les départements universitaires et les laboratoires, paupérisés par la réduction des engagements de dépense, prélèvent des crédits recherche pour payer les frais de fonctionnement. Vrai détournement de fonds devenu institutionnel, dissimulé par une appellation anglaise : overhead (“par-dessus la tête”). Merveille sémantique révélatrice. Le procédé est simple : comme les laboratoires ou les universités avancent les ressources aux chercheurs puis se font rembourser par l’ANR, retenir une part des fonds est facile, d’autant plus facile que l’utilisation des crédits n’est pas contrôlée à la fin du projet. La répartition des crédits de recherche est ainsi devenue nettement moins claire et moins efficace que lorsqu’elle était décidée par les instituts de recherche nationaux (CNRS, INSERM, INRA…), qui en outre examinaient volontiers les recours. Ce saupoudrage confus fait les beaux jours du mandarinat, que la discussion publique limitait auparavant et qui désormais s’en donne à cœur joie.
Une très grande université permettrait-elle d’éviter ce gâchis de temps, d’énergie et de ressources ? Si vraiment l’« expérience UPS » ne concerne que 15% des universitaires français, il pourrait être intéressant de la tenter, en espérant qu’une grande masse financière puisse aussi aider à appliquer l’innovation au développement économique. Mais il est à craindre que ces 15% n’accaparent 85% des crédits nationaux et que, par le simple poids de la hiérarchie, une forte proportion aille aux gras émoluments, au copinage et aux éléphants blancs. La productivité intellectuelle ne bénéficie pas d’économie d’échelle. L’examen des recherches en cours et des projets scientifiques montre que maintes universités de province tracent des voies plus originales que les universités parisiennes, où la compétition internationale a sélectionné un conformisme mou. Soutenir les projets innovants est plus facile dans les universités de petite taille.
S’il y a une réforme à faire dans l’enseignement et la recherche, ce n’est pas d’empiler des maréchaux sur des généraux, c’est de libérer les capitaines et les lieutenants, en leur accordant directement des crédits dont ils seront vraiment responsables. La liberté intellectuelle et l’initiative, et, en contrepartie, la responsabilité. Pour laisser le temps de penser et d’agir, il faut décharger les chercheurs des contraintes paperassières (depuis qu’elle a été dématérialisée par Internet, la paperasserie est sans limite) et, tous les cinq ans, les faire répondre sérieusement de leur activité, de leurs résultats et de l’emploi des ressources qui leur ont été accordées, devant un vrai jury scientifique. Sinon ils continueront à perdre non seulement leur temps mais aussi leur motivation, jusqu’à ce que le découragement les fonde dans la médiocrité des gradés.
-
Cette compétition s’inscrit dans une guerre générale des espaces politiques de “l’Occident”. Elle participe à l’assujettissement des États aux pouvoirs commerciaux, financiers et communautaristes.
“Or la puissance de ces entreprises repose sur la possibilité de création monétaire sans limite des réseaux bancaires anglo-saxons, permise par le privilège du dollar comme monnaie de règlement des achats d’énergie, et ce privilège est à son tour soutenu par des guerres incessantes.”
Des principes très différents ont inspiré les organisations des universités anglo-saxonnes et françaises :
-
Les grandes universités anglo-saxonnes ont des ressources importantes parce qu’elles font payer très cher les études, et parce qu’elles bénéficient de contrats, voire de largesses, d’entreprises d’envergure mondiale. Or la puissance de ces entreprises repose sur la possibilité de création monétaire sans limite des réseaux bancaires anglo-saxons, permise par le privilège du dollar comme monnaie de règlement des achats d’énergie, et ce privilège est à son tour soutenu par des guerres incessantes. Ces universités peuvent donc offrir des salaires élevés à quelques-uns de leurs enseignants. Cette organisation sociale et politique exceptionnelle ne peut évidemment être généralisée. Son imitation irréfléchie conduirait à l’échec.
-
Les universités françaises offrent au contraire l’accès à la connaissance pour un coût modique, et sans guère de sélection à l’entrée. Même les écoles les plus sélectives ouvrent leurs portes aux meilleurs étudiants des universités. Les professeurs sont fonctionnaires publics, et leurs salaires sont fixés par des règles nationales. Les budgets sont donc évidemment moindres que ceux des universités anglo-saxonnes.
Ces deux systèmes ont chacun leur logique, et donc leur organisation. Bouleverser les universités françaises en singeant le système anglo-saxon ne pourrait que les désorganiser. Une très grande université, copiée sur les campus étasuniens, serait une charge coûteuse empêchant le développement des autres universités, et ne résisterait pas au tropisme anglo-saxon : faute de trouver par elle-même, en France, les moyens de son ambition, elle deviendrait bientôt une enclave étrangère.
La recherche ne peut se développer sans une volonté politique. Or, fidèles relais d’un projet marchand promu opiniâtrement par l’Union Européenne, les ministres de la recherche qui se succèdent incitent les établissements universitaires « autonomes » – entendez délaissés par l’État appauvri – à devenir rentables. Les projets des présidents et directeurs tiennent donc en deux lignes :
-
Développer le plus possible d’enseignements payants.
-
Obtenir le plus grand nombre de contrats, au risque de s’engager au-delà du possible et de bâcler l’étude.
Tel est le credo des dirigeants, dont le but affiché est de transformer leur établissement en entreprise profitable.
Augmenter les frais de scolarité des étudiants français n’est jusqu’à présent guère possible sans déclencher de vives réactions de refus. Aussi convient-il de recruter le plus possible d’étudiants étrangers, qui peuvent, eux, être soumis à des frais élevés. L’étranger paiera. Et il paiera d’autant plus qu’est grande l’ambition de l’établissement, car – c’est bien connu – faire payer peu dévaloriserait la compétence aux yeux des clients.
La baisse des dotations contraint déjà les établissements d’enseignement supérieur à s’auto-financer en devenant concurrents des bureaux d’études. Certes, pour un enseignant-chercheur, garder le contact avec la réalité des professions que ses élèves exerceront est nécessaire, et appliquer son talent à un problème pratique peut être stimulant sans être contraire à la morale professionnelle. Mais la résolution de ces problèmes accapare le temps et réduit la recherche fondamentale à une activité de loisir. La chasse au contrat, désormais principale ressource et premier critère de promotion, est devenue obsessionnelle.
Selon l’espoir des gestionnaires universitaires, une université gigantesque permettrait d’importer en masse des étudiants étrangers, pour leur faire payer aussi cher que dans les universités anglo-saxonnes. Une très grande université, hiérarchisée et dotée d’un service financier important, constituerait aussi un « consortium intellectuel » capable de répondre à des appels d’offres lancés par des entreprises supra-nationales. Un exemple de tels projets est l’écriture de logiciels de « fouilles de données » permettant de croiser des fichiers de reconnaissance de voix, d’empreintes digitales, de démarche, etc., afin d’identifier toute personne à la simple approche. Ces projets sont financés par de très grandes entreprises ou par des entités à leur service comme l’Union Européenne. La mise en concurrence des universités pour ces gros contrats participe de « la violence de la compétition internationale. ». Ce projet de très grande université s’inscrit ainsi dans une perspective résolument mondialiste, à l’époque de la remise en cause de l’idéologie mondialiste.
-
-
Le but politique est d’intégrer les instituts de recherche français, en position subordonnée, dans des conglomérats dont les chefs de file sont anglo-saxons ou allemands.
La pression vers l’uniformité, préconisée par l’Union Européenne, suit le principe de mise en concurrence dans tous les segments de la société. Étendre la concurrence aux universités susciterait des inégalités irréversibles, comme dans tous les domaines déjà soumis au libre-échange. Dans un système de libre circulation absolue de la monnaie, le drainage des enseignants-chercheurs vers les universités les plus riches, et donc les plus généreuses, permettrait de concentrer la production de connaissances nouvelles dans les pays du centre de l’empire anglo-saxon, et laisserait la sous-traitance aux universités des pays dominés. Accepter que s’instaure un “marché universitaire”, sans régulation au niveau national, c’est donc condamner les universités françaises à la subordination et au déclin. Pour éviter ce déclassement, il faut pouvoir doter les universités de financements suffisants. Recouvrer la souveraineté monétaire est donc impératif. Il faut aussi que les entreprises et les universités aient intérêt à collaborer, ce qui nécessite de mettre un terme aux délocalisations et, au contraire, de relocaliser la production et la recherche, donc de restaurer des frontières économiques.
“Les directeurs préconisent donc l’abandon de la formation scientifique et technique de base. Voie royale vers la vassalisation et le sous-développement.”
Le risque de déclin de l’activité intellectuelle est réel, et la mode des études de gestion y pousse déjà. Bien des “directeurs des études” des écoles d’ingénieurs s’efforcent de diminuer les horaires d’enseignement scientifique et technique, et de remplacer la compétence ingénieuriale par l’aptitude managériale. Les deux arguments avancés sont que la désindustrialisation de la France rend désormais la compétence inutile, et que les entreprises ne s’intéressent pas aux connaissances des ingénieurs fraîchement diplômés, mais “achètent un potentiel”, consistant en la flexibilité et l’adaptabilité. Les directeurs préconisent donc l’abandon de la formation scientifique et technique de base. Voie royale vers la vassalisation et le sous-développement.
-
Un autre but politique est d’angliciser la France.
Sous la plume d’universitaires inspirés par l’air du temps, paraissent de plus en plus souvent des articles péremptoires prônant l’emploi de la langue anglaise dans l’enseignement supérieur en France. L’avenir des universités dépendrait de leur insertion sur le “marché ” de l’enseignement, dont elles devraient s’efforcer de rafler le plus possible de “clients”, étudiants étrangers assez riches pour payer des frais d’étude élevés. Les “concurrents” étant les pays anglo-saxons, la réussite de cette opération nécessiterait d’enseigner en anglais.
“Les étudiants étrangers qui viennent en France le font pour parler français, pas anglais. Ceux qui veulent parler anglais vont dans les pays anglophones, puisque chacun préfère toujours l’original à la copie.”
Cette vision mercantile est tout à fait contraire au vrai métier d’enseignant et aux intérêts de la France. La langue est en effet un élément fondamental de la cohérence d’un peuple et de l’existence d’une nation. En France, l’enseignement est d’abord au service des Français et des ressortissants des pays francophones. La vocation des universités n’est pas de s’insérer dans un prétendu “marché international de l’éducation” mais d’instruire des étudiants, dont les parents et tous les Français payent les études par leurs impôts. Les étudiants étrangers qui viennent en France le font pour parler français, pas anglais. Ceux qui veulent parler anglais vont dans les pays anglophones, puisque chacun préfère toujours l’original à la copie.
Dans les métiers de l’enseignement et de la recherche, l’échange oral et la publication des résultats sont des actions différentes dont chacune a ses nécessités propres. Si l’anglais est devenu – très récemment à l’échelle de l’Histoire – la langue la plus utilisée pour les publications princeps (mais pas pour toutes), le français est, peut et doit rester la langue de l’enseignement et la langue de travail pour les chercheurs français. C’est toujours un grand moment comique d’entendre dans une salle cinq Français ou Italiens baragouinant entre eux en anglais ; le ridicule ne tue pas, mais peut faire périr l’effort intellectuel. Passer au « tout anglais » n’entraînerait que destruction de la vitalité intellectuelle et corruption de l’enseignement et de la recherche.
Est-ce là un but souhaitable pour la Nation ?
L’abaissement de la langue nationale profite à des pays qui ont toujours cherché à abaisser le nôtre, et suscite la jouissance perverse des classes dominantes qui veulent parler une langue différente de celle des autres Français. Ceux qui prônent cet abandon dédaignent leurs compatriotes, car c’est bafouer l’égalité que de réserver l’accès à la connaissance aux membres d’une minorité élevée dans une langue étrangère. Ils méprisent les citoyens des pays francophones, dont les études seraient dévalorisées sans recours, et qu’ils inciteraient donc à se tourner à leur tour vers l’anglais. Prétendre qu’imposer l’anglais dans l’enseignement développerait indirectement la francophonie (!) est une absurdité malhonnête. Ils taisent enfin que de grands pays (Russie, Chine…) maintiennent tout leur enseignement dans leur langue nationale. La Chine a décidé récemment de supprimer l’épreuve d’anglais obligatoire pour les études scientifiques, ayant remarqué que cette obligation “baissait le niveau” (agence Xinhua). En effet, exprimer les faits clairement et précisément est nécessaire au raisonnement.
-
Enfin, pour les classes dominantes françaises, il s’agit de se séparer du peuple.
En instituant des universités coûteuses, dont une part de l’enseignement serait donnée en langue étrangère, et en opposant une grande université centralisée aux universités de province, les classes dominantes figeraient des écarts sociaux que l’accès de tous à l’enseignement dans la langue nationale avait atténués et que la mondialisation a recréés. Les heureux élus, sélectionnés dès l’âge de quinze ans – et de plus en plus selon les revenus de leurs parents – passeraient toute leur vie dans les tuyaux, sans jamais fréquenter leurs compatriotes : du lycée à l’université, de l’université à un trust apatride ou à des labos de “l’Occident”, et de là au cimetière où ils auraient bien gagné leur place. En jouant au golf le dimanche pour déboucher leurs artères.
“L’injonction d’enseigner en anglais n’est qu’une exhortation à trahir, et qu’un prétexte pour justifier la séparation des classes sociales.”
L’injonction d’enseigner en anglais n’est qu’une exhortation à trahir, et qu’un prétexte pour justifier la séparation des classes sociales. Mais en science l’argument d’autorité n’existe pas. Seules la démonstration et la preuve font autorité. Dans un débat qui engage tout l’avenir de notre Nation, l’abus d’autorité n’a pas sa place.
Georges Pompidou, qui avait certes travaillé pour une banque mais était issu du peuple et avait commencé par enseigner, refusait les campus isolés et voulait maintenir les universités dans les villes, afin que les étudiants soient au contact de leurs compatriotes. À cette époque, il y a quarante ans, les villes rassemblaient encore toutes les classes de la société urbaine. Les classes populaires n’en avaient pas été chassées par la spéculation immobilière effrénée, causée par la libre circulation des capitaux. Depuis, le Quartier latin à Paris est devenu un désert culturel, où les boutiques de fringues ont remplacé les librairies, mais l’opinion de Georges Pompidou n’a rien perdu de sa justesse. Alors que la ségrégation géographique prend une tournure dangereuse, il serait insensé de l’aggraver encore en regroupant les étudiants à l’écart de la vie sociale. Sur de riches terres agricoles, la monoculture d’étudiants en serres bétonnées remplacerait la culture des betteraves et des céréales en plein air.
Les études dans les écoles d’ingénieurs suscitent chaque année, chez quelques étudiants, des troubles de comportement qui toutefois entraînent rarement des conséquences dramatiques. Mais il n’en va pas de même sur les grands campus où se constituent des sociétés fermées d’adolescents tardifs, et telle université célèbre de Nouvelle Angleterre s’est acquis depuis longtemps le surnom de “cité du suicide”.
Il est grand temps de restaurer la vitalité d’une organisation universitaire nationale, où les chercheurs continueront, bien sûr, à se tenir informés de ce qui se fait ailleurs, mais ne se soumettront plus passivement aux modes ni aux manœuvres. Le moment convient d’autant mieux que le regroupement arbitraire des régions, impulsé par les européistes qui s’efforcent de briser les nations, est encore assez récent pour être réversible. Ces grandes régions artificielles, sans réalités humaines, n’ont pas encore fait sentir leurs effets nocifs. Tant dans l’ordre académique que dans le domaine économique et social, la concurrence entre régions ne peut que nuire. Pour la vitalité du pays, mieux vaudrait réduire les administrations régionales à des structures légères de coopération entre départements. Un réseau universitaire cohérent serait constitué d’établissements spécialisés, “professionnalisants” dans les villes moyennes, d’une université dans chaque capitale régionale, et de grandes universités généralistes dans les principales villes du pays (Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg, Toulouse…).
Mais pour redonner de la vitalité, il faut des moyens financiers. Or, si la monnaie permet de conserver la valeur au cours du temps, ce n’est pas parce qu’elle serait par nature un objet doué de valeur propre, mais parce qu’elle symbolise la confiance publique garantie par l’État. Comme tout autre investissement, l’investissement dans la connaissance résulte de l’activité collective, que seule la confiance publique permet. Un pays ne peut être productif que s’il est maître de sa monnaie, qui circule en entretenant la confiance réciproque entre les habitants. Au contraire, la gestion de la monnaie dans le seul but patrimonial de maintenir la valeur des rentes, comme c’est le cas de l’euro, raréfie et réifie la monnaie. La volonté de développer l’activité intellectuelle bute donc sur l’obstacle fondamental auquel tout projet politique achoppe à présent.
Pour retrouver la liberté de penser et d’agir, restaurer la prospérité, rouvrir des perspectives d’avenir, la France doit reprendre sa pleine souveraineté, qui est la condition de la liberté collective, seule accessible aux hommes.






















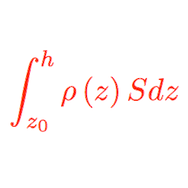




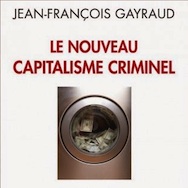








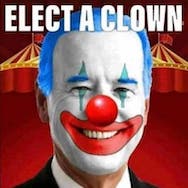















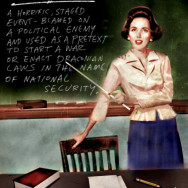

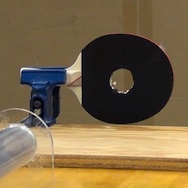


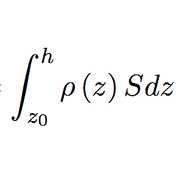






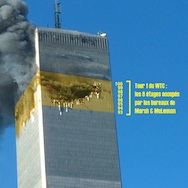



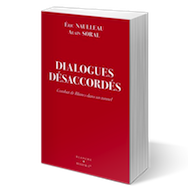


















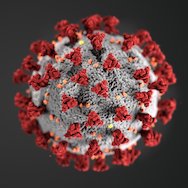
















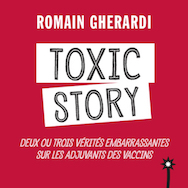
























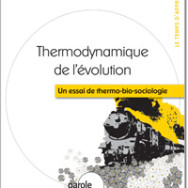
















Un commentaire sur “L’écroulement de la ziggourat ?”