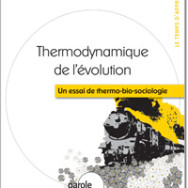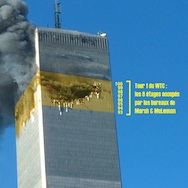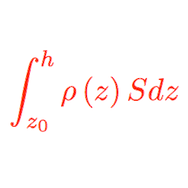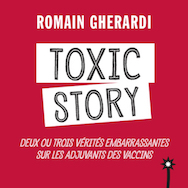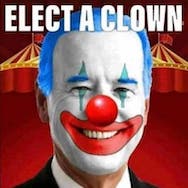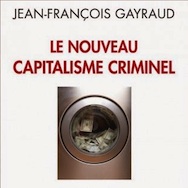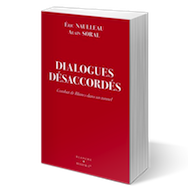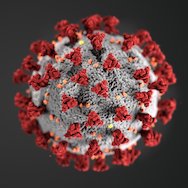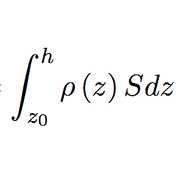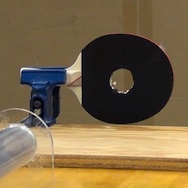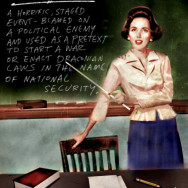[Note de l’administrateur de ce blog : plutôt que présenter des vœux pour 2018, j’ai pensé qu’il était plus utile d’analyser l’année qui vient de s’écouler, afin peut-être d’être moins pris au dépourvu, moins décontenancé, et moins impuissant face aux événements qui ne manqueront pas d’arriver en 2018. Et pour cela, je n’ai pas trouvé mieux que la prose de Slobodan Despot, dont le Drone décolle pour de bon en ce mois de janvier et que je vous invite à soutenir par un abonnement, comme je l’ai fait.
[Note de l’administrateur de ce blog : plutôt que présenter des vœux pour 2018, j’ai pensé qu’il était plus utile d’analyser l’année qui vient de s’écouler, afin peut-être d’être moins pris au dépourvu, moins décontenancé, et moins impuissant face aux événements qui ne manqueront pas d’arriver en 2018. Et pour cela, je n’ai pas trouvé mieux que la prose de Slobodan Despot, dont le Drone décolle pour de bon en ce mois de janvier et que je vous invite à soutenir par un abonnement, comme je l’ai fait.
Je reprends ici un billet double publié les 31 décembre 2017 et 7 janvier 2018 dans Antipresse. La deuxième partie, où il est question de “surréalité”, et en particulier cette phrase : “La stupidité grégaire est devenue aussi obligatoire dans les fonctions publiques que l’était jadis la cravate”, m’a immédiatement rappelé une citation du philosophe français Raymond Ruyer que je mettais en 1992 en exergue d’un des chapitres de ma thèse de sciences physiques. La voici :
Les intoxications par l’instruction sont bien plus graves que les intoxications par les sous-produits de l’industrie. Les encombrements d’information bien plus graves que les encombrements de machines et d’ustensiles. Les indigestions de signes, plus graves que les intoxications alimentaires.
Je ne pensais pas du tout, à l’époque, qu’elle pourrait s’appliquer à une civilisation toute entière.]
Et si le centième anniversaire de la Révolution d’Octobre devait rester dans l’histoire comme l’an 0 de la posthumanité ?
Il neige comme rarement sur mes Alpes et l’Amérique de Nord est envahie d’une vague de froid sans précédent. On nous assure néanmoins — sans préciser les conditions de mesure — que 2017 fut l’année la plus chaude jamais enregistrée. Nous n’en savons rien. Sur ce chapitre comme sur tous les autres, les faits de base sont controversés.
Sur ce chapitre comme sur tous les autres, nous sommes bombardés d’affirmations officielles contrebalancées par des contre-affirmations officieuses. Les médias tendent à réduire cette bataille de l’information à une querelle sur les «faits», or c’est d’un enjeu bien plus profond qu’il s’agit : d’une empoignade dont l’enjeu est la faculté de penser elle-même.
Car pour «se faire une idée», il ne suffit pas de disposer de faits solidement établis. Encore faut-il savoir les lire, autrement dit les lier. Les lier entre eux et les lier à l’ensemble de notre expérience. C’est ce terreau de la conscience souveraine qu’on appelle la culture. Et c’est précisément ce terreau qu’«on» est en train de nous assécher.
Privés de cet ancrage, nous ne pouvons plus rien conclure par nous-mêmes : il nous faut soit admettre sans réserve les vérités ambiantes, soit les rejeter a priori, non parce qu’elles sont douteuses en soi, mais parce que nous avons barré leur source, par expérience ou (plus souvent) par ouï-dire. Nous n’avons plus le temps d’ergoter au coup par coup. Nos maîtres non plus.
Vers une humanité hors sol
La complexification scientifique de notre univers a abouti à son plus grinçant paradoxe : à la simplification primitive de la pensée. Dans leurs tours d’ivoire, des millions d’ingénieurs, de spécialistes et d’experts produisent des «faits» pointus, chacun dans son domaine, ignorant tout de ce que font leurs voisins. Un système médiatique de plus en plus intégré et de plus en plus adossé à l’intelligence artificielle synthétise ces particules de savoir, les trie selon ses critères propres et les agglomère en garmonbozia pour les masses. Et les masses avalent la bouillie sans se poser de questions — ou se posent des questions mais ne savent plus où chercher d’autres nourritures.
Sans nous en rendre compte, nous entrons ainsi dans une forme de guerre civile cognitive. Une majorité crédule admet tout, une minorité suspicieuse rejette tout. Entre les deux, il n’y aura bientôt plus aucun terrain d’entente. Qui se fie à CNN abomine RT et vice versa. Les climatocorrects vouent au bûcher les climatosceptiques. Qui est pour le Bien excommunie ceux qui ne jurent que par le Vrai. Ces partages sont plus forts désormais que les différences confessionnelles ou nationales, et ils traversent les familles et les couples.
Ils sont d’autant plus violents qu’ils ne se fondent pas sur des convictions construites de manière autonome, avec les outils de la logique, de l’expérience et du savoir accumulé, mais sur des slogans. Les réseaux sociaux, tout comme une grande partie des médias de grand chemin, poussent leurs utilisateurs à se grouper en clans et en tribus avec ceux qui pensent comme eux. L’ouverture aux idées d’autrui, malgré le matraquage ambiant (ou à cause de lui) n’est plus du tout à l’ordre du jour. Le débat d’idées n’existe plus, il est remplacé par des guerres de religion.
Ces conflagrations elles-mêmes témoignent de la montée de générations entièrement dépendantes des systèmes d’information/conditionnement qui les entourent, chez qui l’idéal d’un jugement autonome n’est plus qu’un lointain souvenir. Des générations élevées non plus au soleil de la culture, mais sous les projecteurs des fermes d’élevage.
S’il me fallait résumer l’an dix-sept par une seule image, ce serait celle-là. La vision des tomates insipides et identiques cultivées hors-sol dans les serres stériles de Hollande en tant que destinée commune de l’humanité. Cette industrialisation du matériau humain ne date pas d’hier. Ce projet n’est rien moins que le frère jumeau escamoté de la Modernité elle-même. Mais l’an dix-septième du troisième millénaire aura été celui d’un brutal coup d’accélérateur dans ce sens. La tendance est devenue visible partout, mais on peut l’illustrer dans trois ou quatre domaines particulièrement sensibles.
L’école vacillait : aurait-elle basculé?
Le système scolaire, par son exigence et son austérité, compensait jadis la perpétuelle et frivole fuite en avant de la société de consommation. Or il a basculé : ce qui était un frein est devenu un accélérateur. Dans les pays du monde occidental, l’école ajuste de plus en plus ses critères de qualité à des critères d’«égalité», c.à.d. de bienséance morale. Nul besoin de préciser dans quel sens va l’ajustement. Les indicateurs objectifs deviennent impossibles à escamoter.
Dans le reste du monde, pratiquement partout, elle cède aux sirènes du digitalisme, cette nouvelle religion (identifiée par François de Bernard) qui prétend nous rendre plus intelligents avec des béquilles informatiques que nous ne l’étions sans elles. La distribution massive aux élèves de tablettes numériques — ces gadgets que leur inventeur, Steve Jobs, interdisait à ses propres enfants —, subordonne étroitement l’école aux multinationales de l’informatique. Elle s’accompagne d’une déclamation incantatoire d’une platitude confondante sur les bienfaits de la technologie.
Pour que l’école devienne une fabrique du crétin, il a d’abord fallu, bien en amont, que les gérants de l’usine soient eux-mêmes devenus des crétins ou des criminels. On l’oublie trop souvent. En 2017, des séries de signaux clairs sont venues confirmer le diagnostic pessimiste de Jean-Paul Brighelli. Le dernier en date est la dégringolade de la France, patrie de l’école pour tous, laïque et républicaine, dans les bas-fonds du classement des pays en fonction des aptitudes à la lecture de leurs élèves.
En même temps, cette Bérézina de l’enseignement a fini par susciter des prises de conscience et de lourdes révisions, comme celle qu’essaie d’entreprendre le nouveau ministre français de l’Éducation nationale. Il est à craindre toutefois que le mal accompli par l’école post-soixante-huitarde ne soit irréversible.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Que nous aura apporté l’année qui vient de s’écouler ? Poursuite d’un inventaire sous forme de rêverie philosophique.
«J’ai toujours été fasciné par la loi de l’effort inverse. Je l’appelle parfois la “loi du rebours”. Quand vous essayez de rester à la surface de l’eau, vous coulez ; mais quand vous essayez de couler, vous flottez. Quand vous retenez votre souffle vous le perdez, ce qui rappelle immédiatement un ancien dicton trop souvent négligé : “Quiconque veut sauver son âme la perdra.”»
(Alan Watts, Éloge de l’insécurité)
Après avoir publié la première partie de mon retour sur l’an 17, j’ai reçu un message d’une lectrice bienveillante auquel je n’ai pas répondu. J’ai reçu, de fait, plusieurs messages ces dernières semaines auxquels je n’ai pas donné réponse et je prie sincèrement mes lecteurs de m’en excuser. La cause en est cette forme particulière de torpeur métaphysique dont il va être question plus bas.
Ce message, j’y ai repensé au moment de poursuivre mon inventaire sur les sujets annoncés. La suggestion qu’il contenait était de nature à mettre en doute l’ensemble de mon projet :
«…je t’ai lu et j’ai pensé “qu’est-ce que c’est juste, mais c’est triste”. Ça serait bien d’écrire, un jour, sur les bienfaits de la pensée, sur celle qui, de nos jours, existe encore… Une sorte d’élan qui donne envie, mais qui ne camoufle rien. Un peu comme les questions, réflexions que posent des enfants.»
Elle avait raison. Je dépeignais l’année qui vient de s’écouler comme «l’an 0 de la posthumanité». C’est toujours un exercice arbitraire que de poser des jalons fixes dans des processus organiques et de longue haleine, mais il y a de forts arguments en faveur de cette idée. Pour ne pas laisser ma réflexion en chemin, j’en citerai encore un ou deux. Puis je reviendrai sur le cœur de cette remarque.
Les «fake news» en guise de matraque
L’année 17 a été marquée par une lutte titanesque. La corporation journalistique s’est dressée comme un seul homme contre le nouveau président des États-Unis, dont elle n’avait pas su anticiper ni par conséquent prévenir l’élection. Laquelle élection avait été un retentissant camouflet au système d’information global.
Le rouquin roublard lui a bien rendu son hostilité. S’en est suivie une empoignade, peut-être un peu mise en scène, dont la principale victime fut l’objectivité de l’information. Pour discréditer le président-voyou qui les vilipendait — et fédérait du même coup tous les «ennemis du système» — les médias de grand chemin lui ont collé ainsi qu’à ses alliés l’accusation de «fake news». Un peu comme si le patron d’un McDo dénonçait le kebab du quartier pour malbouffe.
Le «hashtag» #FakeNews est devenu le mantra d’un règlement de compte avec toute forme de pensée déviante. Le «journal de référence» français, Le Monde, a ainsi créé son «Décodex» un outil informatisé d’«évaluation» des sources d’information francophones (mais fourni par les laboratoires Google). Lancé en grande pompe, l’index du Monde s’est avéré un outil superficiel et calamiteux, éthiquement injustifiable et, de plus, contre-productif.
L’expérience est néanmoins représentative d’une double évolution des médias de grand chemin. D’une part, elle signe la transformation de leur mission d’information en une mission d’éducation. D’autre part, elle consacre le putsch des géants de l’informatique sur la scène médiatique et le remplacement à venir des rédacteurs humains — de plus en plus mentalement uniformisés — par des algorithmes d’intelligence artificielle. Étant progressistes par (dé)formation professionnelle, les zélateurs du système se sentent en devoir d’applaudir les outils de leur propre élimination.
La surréalité, c’est plus gérable
Le nivellement médiatique est le symptôme d’un processus plus profond initié depuis au moins une quarantaine d’années dans tout le monde industrialisé, URSS comprise. L’hypernormalisation — telle que décrite dans le documentaire exceptionnel d’Adam Curtis [1] est du reste un terme soviétique. Elle désigne la stabilisation d’une société en proie à une dérive foncièrement irrécupérable par l’élaboration d’un «clone» de réalité plus simple et plus maniable que la réalité brute. Ce qui implique avant tout le transfert du pouvoir des structures élues (et donc chaotiques) vers les technostructures rationnelles de l’argent et de l’information.
Le «management de la perception» prend donc le pas sur la politique. Les stratégies de communication prennent un rôle déterminant. Elles se sont particulièrement illustrées dans la gestion du phénomène majeur qui a frappé l’Europe ces dernières années : le flux migratoire.
Face à ce phénomène, on a vu se développer en Europe deux univers parallèles. D’un côté, la réalité : la raison froide, économique et démographique, justifiant cet apport de population, mais aussi le contexte stratégique de la déstabilisation du Moyen-Orient par le néocolonialisme occidental et les problèmes concrets posés par ce mélange forcé des populations et des mentalités. De l’autre, la surréalité : la construction d’un monde parallèle où ces nécessités et ces problèmes n’existent pas. Plus exactement : un monde où il est impossible — tout comme dans un rêve — de relier les effets à leurs causes évidentes.
La fracture s’est étendue à l’échelle des États. À l’est de Vienne : les partisans de la réalité, en gros réunis autour du «groupe de Višegrad». À l’ouest et au nord : les bâtisseurs de la surréalité.
Si les réalistes s’occupent avant tout de sauvegarder leurs repères à l’intérieur du périmètre qu’ils peuvent contrôler, les surréalistes, eux, s’attribuent une mission globale. On ne tolère aucune «altérité» à la surréalité.
L’importation de populations déracinées déborde les calculs socio-économiques qui l’ont initiée, notamment en Allemagne. Elle sert également de levier à un déracinement général portant sur tout ce qu’il y a en nous de déracinable. La propagande pro-migration se déploie partout, jusque sur les emballages de sucreries, sans qu’aucune limite n’y soit posée. L’ensemble du mobilier millénaire européen est retiré pour faciliter le flux. Comme le notait le grand metteur en scène (de gauche) allemand Botho Strauss, «grâce à l’arrivée en masse de déracinés, on met enfin un terme à la nation et, y compris, à une littérature nationale» [2]. Le conditionnement comportemental est si puissant qu’on ne songe même plus que d’autres attitudes face à cette nouvelle donne soient possibles, encore moins légitimes. «On nous ôte le pouvoir d’être contre», clame Botho Strauss. Le concept même d’opposition est en train de se vider de son sens, ainsi que le démontre la spectaculaire montée en insignifiance des partis d’opposition institutionnels.
La surréalité n’est pas un régime stable. Elle est dynamique, circulaire et exponentielle, telle une spirale. Elle remet sans cesse les mêmes sujets sur le tapis, mais d’une manière chaque fois plus appuyée. La migration n’est en l’occurrence que la tête de pont. Sur ses arrières, les populations hébétées découvrent tout l’arsenal du «reformatage» anthropologique auquel on entend les soumettre. Si l’an 1 vous avez été «sensibilisés» aux sexualités alternatives à l’école, vous serez invités l’an 2 à approuver leur mariage, on vous persuadera l’an 3 que l’adoption d’enfants est leur droit le plus élémentaire et, l’an 4, vous trouverez révoltant que des homosexuels à barbe n’aient pas le «droit» de porter des enfants.
Le conditionnement des masses est si efficace que des sujets à peine apparus dans le buzz médiatique deviennent des injonctions aussi naturelles que la loi de la gravité. Quelques semaines à peine séparent le lancement des hashtags #metoo ou #balancetonporc de la censure de La Belle au bois dormant ou de la réécriture de Carmen à l’opéra de Florence. Aucun pilier de notre héritage culturel n’est plus à l’abri des perquisitions policières. Aucune personnalité en vue n’est à l’abri d’inculpations ahurissantes devant le tribunal de meute des médias et des réseaux sociaux. La stupidité grégaire est devenue aussi obligatoire dans les fonctions publiques que l’était jadis la cravate.
Et alors ?
Je ne sais pas si tout ceci est très juste, comme l’écrivait notre lectrice, mais je suis bien certain que c’est triste. Et c’est là que le bât blesse. Il y a une dangereuse forme d’osmose à trop se pencher sur les «problèmes généraux» du monde : on finit par les intérioriser. Par transformer des craintes ou des possibilités en une réalité psychologique. Les «ingénieurs sociaux» des régimes totalitaires du XXe siècle auraient rêvé des outils de la technologie moderne. Le téléscripteur des guerres, des attentats et des catastrophes climatiques cliquette en permanence dans notre poche, sur nos tablettes ou nos ordinateurs. Le transformisme universel est un mouvement hypnotique. Il nous fait prendre la fabrication d’une réalité parallèle pour la vie elle-même. Si nous nous prenons au jeu, nous tombons en prostration.
C’est ce qui m’est arrivé ces dernières semaines. En réfléchissant par concepts, j’ai abouti à la post-humanité. Si j’avais réfléchi à partir de mon expérience personnelle, j’aurais conclu à un festival d’humanité. Durant l’année 2017, j’ai vécu l’aventure unique d’un mois de jeûne sur le lac Baïkal, découvert le vaste Orient russe, le cœur de l’Eurasie, la prodigieuse gentillesse empreinte de spiritualité des Bouriates. J’ai publié chez le meilleur éditeur un roman difficile et pourtant bien accueilli, récompensé même. J’ai aimé, ronchonné, fait la noce, voyagé, rêvé. J’ai entassé des bonnes bouteilles dans la cave d’un ami, «pour le cas où». Où que je sois allé, je n’ai vu que des humains, jamais des androïdes préconditionnés.
Les gens de mon entourage ne sont pas plus dupes que moi des illusions du temps. Mais ils leur accordent moins d’importance.
Car comme les ruisseaux de janvier continuent de chuinter sous leur croûte de glace, la vie continue. Qui se serait attendu à voir arriver en 2017 une œuvre littéraire aussi mûre, aussi puissante que l’Homme surnuméraire de Patrice Jean (présenté dans ce même numéro par le Cannibale lecteur), venant oblitérer des décennies de littérature onaniste ? Qui aurait parié, au tournant du millénaire, sur la possibilité d’une agriculture non industrielle et d’un réel commerce de proximité?
Puis je songe à la vie que mènent mes filles et leurs amis, dans leur milieu ni défavorisé, ni surprotégé. Les années d’études se succèdent, les flirts d’adolescence se consolident en couples solides et respectueux, bientôt en mariages. On cherche un travail pas trop prenant pour se ménager une vie à soi. On entretient ses cercles d’amis. On regarde des séries, on joue de la musique, on économise pour voyager. On lit. Je découvre dans cette génération de surprenants témoignages de responsabilité et de miraculeuses zones de silence. Je comprends alors que leur indifférence aux idées est peut-être, comme sous l’ex-URSS, le signe d’une ironique sagesse. Cette folie passera elle aussi. On en viendrait à oublier que toutes les expériences de Frankenstein se heurtent à une limite infranchissable : l’imperfection de notre condition humaine et l’imprévisibilité du destin.
La voilà, cette pensée vivante que réclame notre lectrice : voir le monde comme le voient les enfants, tel qu’il est, et non tel qu’il risque d’être. Et le saisir à bras-le-corps, en adulte, se souvenant que le temps est la seule denrée non renouvelable de notre bagage humain.
- Voir «Pourquoi il ne se passe rien ?», Antipresse n° 101 du 5.11.2017.
- Botho Strauss, «Une tragédie qui enfle» (Anschwellender Bocksgesang), traduction exclusive dans l’Antipresse N° 14 du 6.3.2016.